Nos services
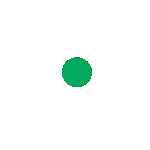
Nos médecins sont en ligne
Consulter

La poliomyélite est une infection aiguë causée par le poliovirus, un entérovirus à ARN qui cible essentiellement les neurones moteurs du système nerveux central, entraînant une destruction des cellules de la corne antérieure de la moelle épinière ou du tronc cérébral.
Cette maladie touche principalement les enfants de moins de cinq ans, et est transmise le plus souvent par la voie oro-fécale. Elle peut entraîner une paralysie flasque aiguë et, sans prise en charge rapide, le décès par insuffisance respiratoire.
En 1949, Enders, Weller et Robbins réussissent à cultiver le poliovirus en laboratoire, ouvrant la voie aux vaccins. En 1955, Jonas Salk met au point le vaccin inactivé (IPV) et le teste sur 1,6 million d’enfants, réduisant de 90 % les cas aux États-Unis. En 1961, Albert Sabin lance le vaccin oral (OPV), plus efficace pour interrompre la transmission virale en milieu communautaire.
Depuis la mise au point de doses du vaccin inactivé de Jonas Salk en 1955, puis de la forme orale d’Albert Sabin quelques années plus tard, la vaccination a permis de réduire les cas de plus de 99 % depuis 1988, avec seulement deux pays (Afghanistan et Pakistan) ayant rapporté des cas de poliovirus sauvage en 2024. L’effort mondial coordonné par la Global Polio Eradication Initiative (GPEI) repose sur la vaccination de masse (IPV et OPV), la surveillance des eaux usées et le maintien de la couverture vaccinale. Enfin, environ 25–40 % des anciens malades paralysés développent, 15–40 ans plus tard, le syndrome post-polio, caractérisé par une fatigue musculaire et une douleur chronique. La polio peut entraîner une paralysie irréversible, voire la mort dans les cas les plus graves.
Bon à savoir : Les enfants de moins de cinq ans sont les plus vulnérables, mais toute personne non immunisée peut être infectée.
L’Organisation mondiale de la Santé rapporte les faits suivants liés à la poliomyélite :
En 1988, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires ont lancé la GPEI, avec un objectif clair : éradiquer la polio à l’échelle mondiale. À ce jour, deux des trois sérotypes de poliovirus sauvage (types 2 et 3) ont été déclarés éradiqués, ne subsistant que la souche du poliovirus sauvage de type 1 (WPV1).
En 2024, on dénombrait moins de 200 cas de WPV1, contre 350 000 à la fin des années 1980. Parallèlement, des souches de poliovirus dérivés de vaccins (VDPV) continuent de circuler dans des zones où la couverture vaccinale orale est insuffisante.
En effet, en 2024, l’Afghanistan a signalé 23 cas et le Pakistan 39 cas de WPV1, avec une augmentation marquée par rapport à 2023, et des échantillons environnementaux positifs signalant une transmission cachée. En outre, les souches de poliovirus dérivées de vaccins (cVDPV) continuent de circuler dans plusieurs régions d’Afrique et d’Asie, nécessitant des campagnes ciblées avec des vaccins monovalents.
Le virus se transmet principalement par :
En effet, le virus de la poliomyélite se multiplie dans la muqueuse pharyngée et dans l’intestin grêle. Il peut être retrouvé dans la gorge et les selles. Sa transmission est exclusivement interhumaine et s’effectue essentiellement par voie féco-orale en particulier par l’intermédiaire d’eau souillée et d’aliments contaminés par les selles.
Les personnes infectées peuvent transmettre l’infection tant que le virus persiste dans la gorge (une semaine) et dans les excréments (3 à 6 semaines, voire davantage).
Créée en 1988, la GPEI rassemble l’OMS, l’UNICEF, le Rotary, le CDC, la Fondation Gates et Gavi. En 2024, les cas de VDPV ont chuté de 40 % par rapport à 2023, ce qui illustre un progrès notable. Toutefois, les clusters en contexte de conflit (freinent l’éradication.
En effet, les principaux défis rencontrés par la GPEI sont entre autres :
Après certification de l’éradication, la GPEI planifie de :
La poliomyélite peut se présenter sous plusieurs formes.
Environ 1 % des cas évoluent vers la paralysie flasque aiguë, qui affecte typiquement les membres inférieurs. La paralysie survient rapidement, souvent en moins de 24 h, et peut être asymétrique :
Des décennies après l’infection initiale, certaines personnes développent le syndrome postpolio (PPS) qui se manifeste par :
La prise en charge du PPS inclut des techniques de pacing et une kinésithérapie adaptée pour éviter la sur-sollicitation des muscles.
Le diagnostic de la polio repose sur le constat d’une paralysie unilatérale d’apparition brutale. Ce diagnostic est confirmé par la détection d’un poliovirus dans les selles ou via un prélèvement nasopharyngé du patient.
Bon à savoir : La surveillance sérologique de l’OMS comprend l’analyse des échantillons d’eaux usées pour détecter de façon précoce la circulation du virus, même en l’absence de cas cliniques.
Il n’existe aucun traitement curatif contre la poliomyélite. Le traitement repose principalement sur l’atténuation des symptômes et la prévention des complications. Ce traitement peut comprendre :
En France, la vaccination DTP (diphtérie – tétanos - poliomyélite) est obligatoire pour les nourrissons et pour les professionnels de santé. La vaccination diphtérie - tétanos - poliomyélite ne comporte que deux doses, injectées respectivement à l'âge de 2 mois et de 4 mois, suivies d'un rappel à 11 mois.
La prévention repose principalement sur la vaccination. Deux types de vaccins sont utilisés :
Les schémas vaccinaux varient selon les pays. En France, les nourrissons reçoivent trois doses d’IPV à 2, 4 et 11 mois, avec un rappel à 6 ans. En zones endémiques, des campagnes d’administration de l’OPV sont organisées trimestriellement pour atteindre tous les enfants de moins de 5 ans.
Bon à savoir : Un nouveau vaccin oral stabilisé (nOPV2) a été déployé depuis 2021 pour réduire le risque de VDPV de type 2, avec plus de 450 millions de doses administrées, marquant une avancée vers l’éradication finale.
D’autres actions peuvent être menées à titre individuel afin d’aider à l’éradication de cette maladie. Il s’agit entre autres pour chacun de :
La paralysie induite par la polio entraîne des coûts de soins à long terme, d’appareillage orthopédique et de prise en charge sociale, grevant ainsi les systèmes de santé, surtout dans les pays à ressources limitées.
L’avis des experts de MédecinDirect sur la poliomyélite :
La poliomyélite est une maladie grave, mais évitable grâce à des doses de vaccination. Les efforts mondiaux ont permis des avancées significatives vers son éradication, mais une vigilance constante est nécessaire pour prévenir toute résurgence. Il est primordial de maintenir une couverture vaccinale élevée et de renforcer les systèmes de surveillance, en particulier dans les zones à risque.
SOURCES :
Retrouvez ici les réponses aux questions que vous pourriez vous poser