Nos services
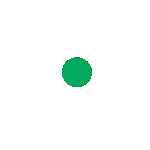
Nos médecins sont en ligne
Consulter
.webp)
On parle de dépendance quand le besoin de répéter la consommation vient satisfaire un manque, une envie et se reproduit de plus en plus souvent. Au départ, la consommation plus ou moins occasionnelle se fait « usage », puis se transforme en « abus » quand elle commence à avoir des conséquences négatives.
Le stade de dépendance est le stade ultime pendant lequel le besoin de consommer prend toute la place dans la vie de l'addict qui a pourtant conscience des problèmes qu’il lui pose au quotidien (santé, financier, relationnel, etc.).
Il est utile de préciser la notion de dépendance dans le cadre actuel :
Le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) regroupe les addictions aux substances sous la dénomination de « troubles liés à l’usage de substances » et inclut également certaines addictions comportementales (par exemple le jeu pathologique). Ce cadre diagnostique, basé sur 11 critères, permet de déterminer la sévérité :
Tableau récapitulatif des 11 critères de diagnostic du trouble lié à l’usage de substances (Substance Use Disorder) selon le DSM‑5 :
On peut être dépendant à :
Qu'il s'agisse des jeux en ligne, du casino, des réseaux sociaux, d'achats compulsifs, de nourriture, ou de sexualité, l'addiction règne dans la vie de la personne en lui imposant de recommencer sans cesse.
En fonction de l'intensité de la dépendance, les signes surviennent de façon plus ou moins intense avec des conséquences dans la vie privée et/ou professionnelle. Dans les cas les plus graves, c'est toute la vie quotidienne et qui est centrée sur l'addiction et la recherche de satisfaction.
Le craving (envie irrépressible) est un marqueur central : la personne ressent un besoin intense de consommer la substance ou de pratiquer le comportement. Ce désir peut survenir de façon spontanée ou en réponse à un stimulus (lieu, émotion, situation) et devient difficile à repousser. En cas de craving fréquent, il y existe un fort risque de rechute si la personne tente d’arrêter.
La personne fait plusieurs tentatives infructueuses pour réduire ou arrêter sa consommation ou sa pratique. Malgré la conscience des conséquences négatives, elle est incapable de limiter la quantité, la fréquence ou la durée. Ce critère se manifeste par des promesses non tenues à soi-même ou à l’entourage.
Une grande part de la pensée quotidienne est occupée par la substance ou le comportement : planification de la prochaine consommation ou session, anticipation du moment de « prendre sa dose », stress si l’objet de la dépendance n’est pas accessible. Cette remarque s’applique tant aux substances (alcool, cocaïne) qu’aux comportements (jeux vidéo, réseaux sociaux, achats compulsifs).
Un critère clé est le temps considérable passé à obtenir, consommer, récupérer d’une substance ou à se livrer au comportement addictif. Ce temps nuit aux obligations professionnelles, scolaires ou familiales : retards répétés, absentéisme, échecs scolaires ou perte de productivité au travail.
De plus, la personne peut abandonner ou réduire des activités sociales, professionnelles, sportives ou de loisirs, autrefois appréciées, en faveur de la dépendance.
Malgré des problèmes relationnels, financiers, judiciaires ou de santé, l’usage persiste. Par exemple, continuer de boire malgré un conflit conjugal ou des difficultés au travail liées à l’alcool ; poursuivre le jeu malgré des dettes ; rester des heures sur les écrans malgré le constat de troubles du sommeil ou de la vision.
La consommation ou le comportement continue dans des contextes à risque : conduire sous l’influence d’une substance, manipuler des machines ou prendre des décisions importantes (par exemple négocier un contrat) en état d’euphorie provoquée ; exposition à des situations potentiellement dangereuses pour satisfaire le craving.
La tolérance se manifeste par la nécessité d’augmenter les doses ou la fréquence pour obtenir les mêmes effets ressentis initialement. Par exemple, boire de plus en plus d’alcool pour ressentir l’euphorie, ou passer davantage de temps sur une plateforme digitale pour éprouver la satisfaction antérieure. La tolérance reflète une adaptation neurobiologique de l’organisme ou du cerveau, nécessitant un usage croissant pour maintenir l’effet.
À la réduction ou l’arrêt de la substance ou du comportement, surviennent souvent des symptômes désagréables (sevrage) :
Les symptômes de sevrage peuvent pousser la personne à reprendre la consommation pour éviter l’inconfort.
L'addiction n'épargne personne et peut concerner aussi bien les hommes que les femmes, à n'importe quel âge. Plus tôt elle est détectée, et plus il sera possible d'agir pour l'aider. Certains éléments peuvent alerter quant à une consommation problématique, voire même une addiction déjà installée :
Qu’elle vous concerne ou une personne de votre entourage, pour traiter la dépendance, la motivation ne suffit pas. Même en ayant conscience de la nocivité du comportement, l'addiction oblige la personne prisonnière à recommencer. Seule l'aide d'un professionnel, médecin traitant, psychiatre ou addictologue permet de se sevrer d'une dépendance de façon durable, en évitant de remplacer une addiction par une autre.
Dans certains cas, un traitement substitutif peut être proposer pour éviter les symptômes de manque physique. Depuis quelques années, les Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), structures présentes dans chaque département, regroupent des professionnels de santé (médecins, addictologues, psychiatres, infirmiers…) à l'écoute des personnes dépendantes et de leur entourage, quel que soit l'addiction concernée.
Reconnaître les signes d’une dépendance est une étape importante, tant pour les personnes concernées que pour leur entourage. Trop souvent, les troubles liés à l’usage de substances ou les addictions comportementales sont minimisés, mis sur le compte du stress, ou perçus comme un manque de volonté. Pourtant, il s’agit bien d’un trouble neurobiologique, avec des mécanismes cérébraux identifiés, impliquant les circuits de la récompense, de la mémoire et du contrôle.
Ce qui doit alerter, c’est la perte de contrôle, le temps consacré à la substance ou au comportement, les conséquences négatives persistantes sur la santé, les relations ou la vie professionnelle, et surtout, la poursuite malgré la conscience du problème. Nous ne parlons pas d’un simple excès ponctuel, mais d’un trouble qui modifie durablement les comportements, les priorités, et parfois la personnalité.
Il est important de rappeler que des solutions existent. Aujourd’hui, la prise en charge des addictions repose sur une approche bienveillante : soutien psychologique, thérapies cognitivo-comportementales, prise en charge médicale si nécessaire, groupes de parole, accompagnement social… Nous voyons chaque jour des patients qui reprennent le contrôle de leur vie, parfois après des années de lutte.
Dès qu’un doute s’installe – que ce soit chez vous ou un proche – n’attendez pas que les conséquences s’aggravent. Le meilleur réflexe est de consulter un médecin ou un addictologue. Il ne s’agit pas de juger, mais d’évaluer, d’informer et de proposer une prise en charge adaptée. La dépendance est une maladie, pas une faute. Et comme toute maladie, plus elle est traitée tôt, meilleures sont les chances de rémission.
Retrouvez ici les réponses aux questions que vous pourriez vous poser